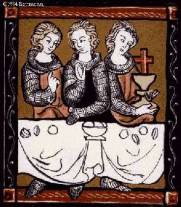
La légende
du Saint Graal
Entre mythe, histoire et littérature
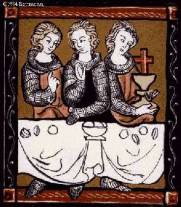
Me voici à un sujet plein d’attrait et qui relie encore l’esprit de l’homme médiéval à notre esprit.En effet, nous avons encore Indiana Jones devant nos yeux, l’archéologue intrépide qui, dans un film tombe dans une grotte remplie de vases et de calices, et parmi bien d’autres, choisit à coup sûr le vrai Graal, un pauvre calice en bois, de provenance franciscaine. Et justement l’épopée du Graal naît dans cette atmosphère littéraire de la France méridionale, la Langue d’Oc, la Provence, où déjà les Croisades, la recherche des reliques, l’amour courtois, le mythe des chevaliers et l’aventure spirituelle deviennent littérature, nostalgie, élégie. Dans le Perceval de Chrétien de Troyes, poème inachevé où apparaît pour la première fois la précieuse coupe de l’ultime Cène, on ressent la nostalgie à l’égard d’un monde parvenu désormais à ces dernières expressions de civilisation. Selon cette tradition littéraire, Joseph d’Arithmatie aurait recueilli dans cette coupe le sang du Rédempteur au Calvaire et l’aurait mystérieusement transporté en France, où se trouvait le Château du Roi pêcheur. La même tradition est reprise par Robert de Boron dans son Joseph d’Arithmatie, et arrive en Allemagne. Là, elle est reprise par Wolfram von Eschenbach, dans son Parzival, qui deviendra la base de l’œuvres symphonique de Wagner. Ce qui surprend c’est toute cette littérature aujourd’hui encore fantastique sur la coupe mythique, jamais retrouvée, mais qui serait conservée bien cachée quelque part. Même le réseau Internet fournit sa contribution, avec une série de sites aux graphismes séduisants, mais qui malheureusement donnent pour sources journalistiques véridiques ce qui ne rencontre ponctuellement pas de confirmation sinon dans des romans qui mélangent imaginations et manipulations historiques construites à dessein de but lucratif, un peu comme le fameux roman Da Vinci code. La légende du Graal s’insère donc dans les grands cycles de romans et légendes chevaleresques qui caractérisent la dernière période du Moyen-Âge : cycle arthurien, cycle de la Chanson de geste, cycle de Perceval caractérisent la plus grande célébration et la fin du mythe de la Chevalerie, justement au moment où naît l’Ordre des Templiers, si fascinant et controversé.

Il est intéressant de se demander cependant quel lien profond pousse encore vers cette légende, quelle valeur positive nous pouvons y trouver. Et les réponses sont variées et à différents niveaux. Quelques-unes ont un aspect historique avéré et servent d’arrière-plan à l’invention littéraire du mythe.
Lorsque Chrétien de Troyes écrit son Perceval (ou Conte du Graal), nous sommes au plein de la grande épopée des Croisades, vers 1190. À cette période, les pèlerins et les croisés, qui se rendent en Terre Sainte, en reviennent avec un grand nombre de reliques, fruits d’un mouvement de foi qui a peu d’équivalents dans l’histoire. La recherche des reliques correspond à la recherche du lien avec la vie de Jésus Christ et des traces qu’Il a laissées de son passagium. Ce lien ou la recherche de ce dernier pousse souvent les hommes médiévaux à alimenter des légendes dans lesquelles la fondation des Églises les plus importantes, ou la formation des États et des dynasties est reliée à la prédication apostolique et à la présence de témoins directs de la vie du Christ et de ses premiers disciples. Ces témoins laissent dans les régions où ils ont prêché des traces de leur passage, de leur prédication.Ainsi Saint André, frère de Saint Pierre, prêche aux alentours de Kiev et prophétise sur le grand avenir de la nation russe, selon la plus ancienne chronique russe. Ou bien Saint Marc, rédacteur de l’Évangile, prêche dans la Vénétie Julienne, et cette prédication est la base de la puissance vénitienne. Ou encore Saint Denys, disciple grec de Saint Paul, qui s’avance en France jusqu’à l’Île de la Cité, en confirmation de la future grandeur du peuple franc.

La présence des précieuses reliques dans les diverses basiliques est une confirmation de ce qui est cru et qui constitue le fondement religieux de la naissance des sanctuaires, de mouvements religieux et des pouvoirs politiques. La recherche des reliques correspond donc, au niveau spirituel, à un cheminement de foi à la recherche de sa propre dimension spirituelle, de sa propre vocation et de ce lien unique et indicible qui se réalise entre la vie du Christ, celle des Saints et de l’Église pèlerine. Ce lien est vécu par l’homme médiéval, surtout par la Chevalerie croisée, comme un serment personnel très semblable à celui d’allégeance , c’est-à-dire qui lie de manière indissoluble la personne à son Seigneur et maître. Dans ce sens, la recherche du Graal est un peu comme la recherche du lien le plus profond possible avec le Christ souffrant et sauveur. Aujourd’hui, cette recherche si profonde de vérité spirituelle et de foi ne fait plus partie de la société, mais est souvent recluse dans le privé et fourvoyée par la recherche du mystérieux et du magique. En effet, comme toujours, il est difficile d’accepter le mystère de souffrance et de gloire lié à l’extrême et total sacrifice de soi à Dieu, qui se réalise dans la figure du Christ et dans sa Passion, et qui se renouvelle dans l’Eucharistie, dont le Graal représente l’institution.

Outre cela, la recherche du Graal et les romans de Chevalerie à laquelle elle se réfère, s’insèrent dans un moment de crise de la foi en la présence du Christ dans l’Eucharistie qui trouve une expression dans l’hérésie cathare et albigeoise. Mais cette crise semble encore se présenter aujourd’hui quand on veut identifier le Graal, non plus comme le Calice de la Passion, mais comme une pensée fourvoyante et parfaitement dépourvue de témoignages historiques contemporains ou voisins de la vie du Christ. Une pensée qui s’est développée beaucoup plus tardivement et qui est liée à la Maçonnerie, donc au dix-huitième et dix-neuvième siècles, quand le Moyen Âge était bien fini depuis longtemps. Et voici que cette pensée bien présente encore aujourd’hui est faussement attribuée au Moyen-Âge. En effet, Scientisme et magie, pouvoir et art des mystères, sont on ne peut plus étrangers à la culture littéraire, civile et religieuse, qui produisit au Moyen-Âge la légende du Saint Graal. La vraie recherche du Graal, comme la ressentirent les médiévaux, ou pour le moins, telle qu’elle résulte pour nous des romans du cycle arthurien ou de Chrétien de Troyes, ou de von Eschenbach, fut une recherche de spiritualité, une recherche de vérité de foi. De cette précieuse relique, le calice de la Passion, naît pour celui qui la possède non pas tellement une sorte de pouvoir magique, mais bien plus une conscience plus profonde de soi. Et comment s’acquiert cette conscience selon l’esprit de l’homme médiéval ?
Voici la belle réponse qu’ils nous ont transmise : à la lumière du Graal, à savoir à la lumière du Christ, de son mystère de Passion, mort et résurrection. À la lumière de l’Eucharistie se retrouve et s’accepte l’être propre, avec qualités et défauts, avec grandeur et misère, et l’on est capables d’entreprendre le cheminement vers Dieu, ce cheminement de recherche que tant d’hommes médiévaux effectuèrent dans les pèlerinages, dans la recherche théologique, dans les vocations monastiques.
Source : le poème Perceval de Chrétien de Troyes.
Source: la Chanson de Roland